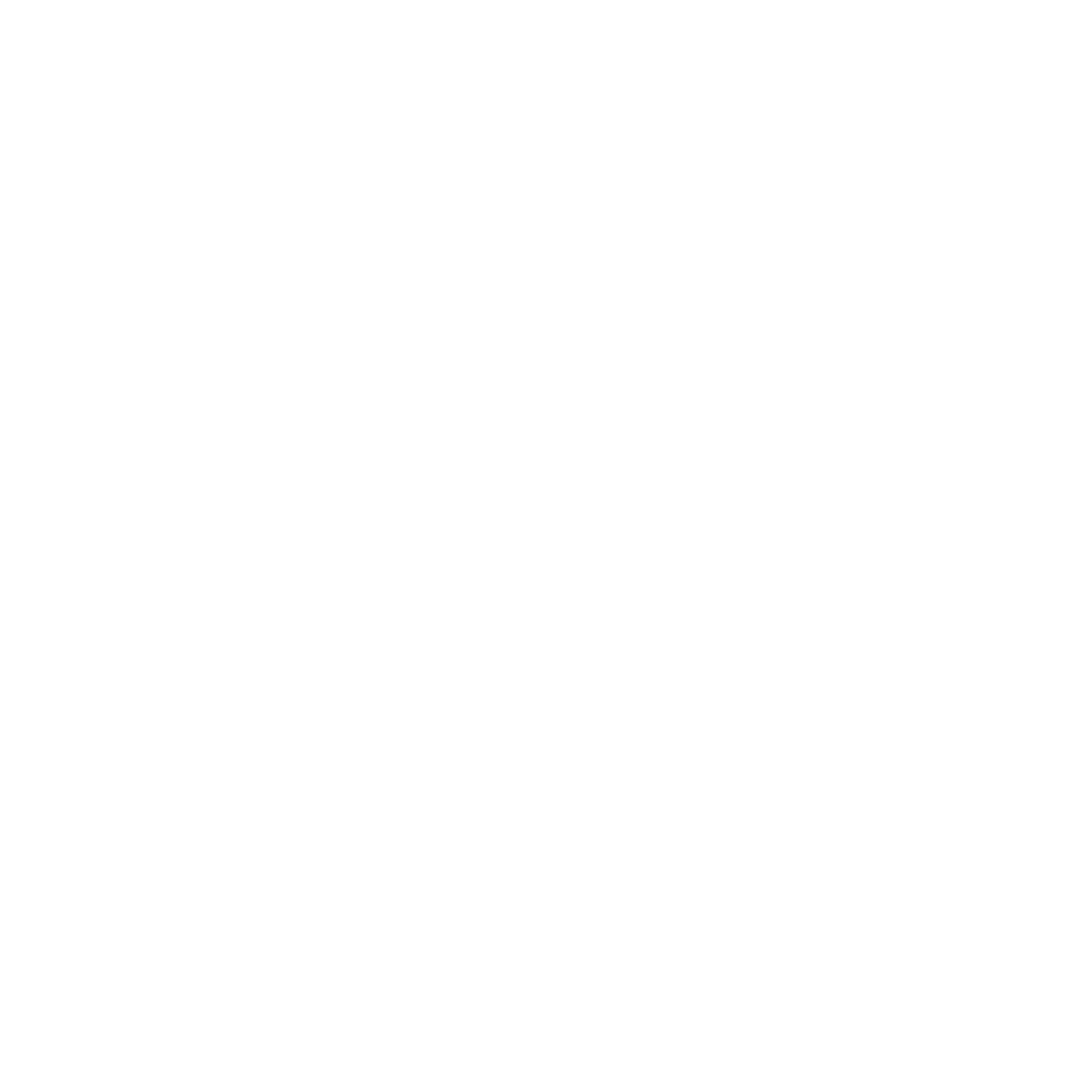Le géographe face aux autocrates : qui l’emportera ?
« La géopolitique est l’art de la stratégie dans un monde où les frontières sont en constante évolution. »
Zbigniew Brzezinski
Les lubies meurtrières et conquérantes d’un dirigeant russe, le retour en 2025 des facéties d’un dirigeant des États-Unis-d’Amérique et l’expansionnisme impérial de plusieurs états (Chine, Venezuela entre autres) bousculent les certitudes établies depuis près d’un siècle en matière de droit international pour le plus grave, de conventions toponymiques pour le plus anecdotique.
_____________________________________
Avant-propos : Travaillant depuis la France, je jouis du fait que ce pays est très très loin d’être une dictature et me permet de rédiger cet article. Je serai en totale incapacité de l’écrire si je résidais en Russie, en Chine ou en Corée-du-Nord par exemple. Ne pas représenter la Crimée comme étant Russe ou Taïwan comme étant une province chinoise pourrait dans ces deux pays être considéré en 2025 comme étant de la trahison ou de la subversion. Je risquerai le pénal, ma sécurité et ma liberté seraient compromises. En Russie, je serai sous le coup de l’article 275 de son code pénal. En Chine sous le joug de l’article 110 (au mieux) de son code pénal. Si j’étais aux États-Unis, je risquerais peut-être l’ostracisation de certains fervents supporters de Donald Trump et serait éventuellement accusé d’antipatriotisme. Mais étant une toute petite structure, j’y resterais néanmoins libre.
La suite de l’article va donc présenter le contexte qui m’anime en tant que cartographe ayant la chance de résider en France.
______________________________________
Le Droit International et la Souveraineté
Le droit international est actuellement ce qui permet, entre autres, le statu quo et, de façon très simplifiée, aux petits pays d’exister et d’assurer la reconnaissance mutuelle de la souveraineté des États entre eux. C’est ce qui régit les relations entre les états. Il permet aux nations d’éviter ce qu’on appelle improprement (car ils ont toujours existé) des « conflits du XIXe siècle ». Lors desquels faire la guerre à son voisin était courant car la reconnaissance internationale d’un territoire n’était pas normée.
Certains pays comme la Pologne ont été constamment ballottés et envahis. Le collège des nations reconnaît par exemple Monaco, Andorre et la Belgique comme des nations indépendantes ayant des territoires bien définis par leurs frontières. Si demain la France, dans un esprit carolingien ou napoléonien, décidait d’envahir ces trois états, il y a fort à parier qu’aucun de ces pays ne résiste militairement. En revanche, la France s’exposerait à l’opprobre globale.
L’Impérialisme Russe et Trump II
Mais cette opprobre n’est hélas plus si certaine et dissuasive que cela. C’est cet esprit napoléonien impérialiste qui anime la Russie depuis une trentaine d’années. Elle a envahi la Géorgie deux fois (en Abkhazie, puis en Ossétie-du-Sud) puis récemment l’Ukraine deux fois aussi (en 2014 en Crimée puis en 2022 dans le Donbass). La deuxième invasion de l’Ukraine était censée être une victoire facile s’appuyant sur une supériorité militaire de fait. Le but était d’offrir à la Russie un accès à toutes les ressources minières du Donbass, de se créer une sorte de glacis, une meilleure façade défensive géostratégique et de légitimer des revendications ultérieures, comme celles de la Novorossia.
À la suite de l’invasion de l’Ukraine en février 2022, la Russie s’est exposée à tout un tas de sanctions internationales. Elle avait enfreint ces deux principes de souveraineté et de droit international. Le risque est que ce membre permanent du conseil de sécurité de l’ONU crée une dangereuse jurisprudence. Malheureusement, cette dernière a déjà commencé avec le Venezuela qui revendique près des deux tiers du « petit » Guyana voisin.
Le dernier cas de figure d’un gros envahissant un petit, a vu en 1990 une coalition d’états aux idéologies totalement différentes se joindre sous l’égide de l’ONU pour libérer le petit Koweït de l’invasion irakienne. Malheureusement, le contexte mondial en 2025 est bien différent.

Crédit photo : Cancillería Argentina. CC BY 2.0
Plus inquiétant, depuis le retour au pouvoir de Donald Trump en 2025 à la présidence des États-Unis, c’est ce pays, chantre de la défense du droit international qu’on caricature souvent comme le shérif de la planète, le policier du monde, qui se met à bafouer quelque chose qui est presque dans son ADN national.
Mais plus inquiétant, depuis le retour au pouvoir de Donald Trump en 2025 à la présidence des États-Unis, c’est ce pays, chantre de la défense du droit international qu’on caricature souvent comme le shérif de la planète, le policier du monde, qui se met à bafouer quelque chose qui est presque dans son ADN national. Alors, les États-Unis sont loin d’être un parangon de vertu, les plus anti-américains de mes lecteurs se seront sans doute étouffés lors de la lecture de ma phrase précédente. Ils auront raison d’évoquer l’histoire des république bananière et du rôle des USA dans l’existence même de ce terme, ils auront raison d’évoquer l’invasion de la Grenade en 1983, du Panama en 1990 (entre autres) et ils auront raison d’évoquer l’ingérence directe des politiques étasuniennes dans celle de bon nombre d’états. Mais à l’inverse de Poutine, même lors de ces invasions, les États-Unis n’ont jamais tenté de revendiquer ces territoires et d’agrandir sa souveraineté de jure. Depuis 1898 et la guerre hispano-américaine contre l’Espagne, ce pays n’a plus agrandi son territoire et les USA sont figés dans ses frontières*.
La donne change, Donald Trump menace d’annexer le Canada, le Groenland et le canal de Panama afin d’en faire des territoires étasuniens sous la souveraineté pleine et entière de son pays. Les motifs sont les mêmes que ceux de la Russie : intérêts économiques, géostratégiques et invocation de la menace d’un péril sur la nation. Le plus inquiétant c’est que ces revendications se font vis à vis d’états « amis » et même alliés militaires : le Canada et le Danemark (pour le Groenland) sont deux membres de l’OTAN.
* exception faite de l’achat de Guantanamo à Cuba en 1903 et des îles Vierges danoises (Sainte-Croix, Saint-Thomas et Saint-Jean) au Danemark en 1917.
La Cartographie et la Neutralité
Les cartes du monde sont toujours la résultante de l’histoire militaire et de la géopolitique. Le monde change perpétuellement, plus qu’on ne le croit. Ces cinq dernières années, j’ai dû à plusieurs reprises mettre mes mappemondes à jour. Seulement, il y a quelques limites. Mon premier article sur ce blog expliquait les choix du cartographe. Je vais revenir là dessus au regard de l’actualité et développer l’existence ou non de la neutralité chez le cartographe.
Pour prendre un exemple très simple : le conflit israélo-palestinien. La neutralité sera perçue par chaque camp comme étant favorable au camp adverse. Le tracé des frontières, l’existence de celles-ci ou le choix des toponymes impliquent un choix qui sera forcé de décevoir un camp, quelles que soient mes convictions personnelles.
Si les revendications hallucinantes de Trump sont encore hypothétiques, celles de Poutine sont actuelles. Quelle représentation du conflit aborder ? Comment mettre à jour mes cartes, dois-je le faire tout de suite ou attendre la fin du conflit ? La Crimée et les oblasts annexés doivent-ils être territoires russes, ukrainiens ? Dois-je adopter une position neutre et mettre des pointillés sur les frontières ? Comme pour l’exemple Israël-Palestine, la neutralité ultime n’existe donc pas. Ce qui sera représenté sur la carte sera issu d’un choix, le choix du cartographe.
La Crédibilité du Cartographe
La part de choix personnel est cependant petite. Celle dictée par la réalité du monde lui est largement supérieure. C’est ce qui nous amène à la seconde partie de cet article : le choix de Donald Trump de renommer le Golfe du Mexique.
« Tout est permis, mais tout n’est pas utile; tout est permis, mais tout n’édifie pas. »
Paul de Tarse
Cette sagesse biblique que Paul écrivit dans son épître aux Corinthiens n’était pas destinée à être appliquée à la cartographie. Mais elle y trouvera une certaine résonance.
Il m’est tout à fait possible de suivre les revendications russes et de présenter le monde tel que Poutine l’imagine. Faire ainsi apparaître comme états indépendants l’Ossétie du Sud-Alanie ou encore la République moldave du Dniestr, que seule la Russie reconnaît. Ma crédibilité à retranscrire ainsi la réalité du monde serait très fortement impactée car ce choix serait très politisé.
Elle le sera d’autant plus si je m’accorde des libertés à renommer à ma guise certaines villes ou pays. Prenons un élan d’une hypothétique passion pour Napoléon que j’aurai. Si je remettais tout ou partie de son empire en tant que territoire français sur une carte de 2025, que quelqu’un m’achète une carte représentant le monde, il verrait que Rome serait une ville française et que les frontières de la France iraient jusqu’en Grèce. Je peux également, mu par une pulsion helléniste et hellénophile, choisir de conserver le nom de Constantinople plutôt que Istanbul pour désigner la plus grande ville de Turquie. Mais on pourra à raison m’accuser d’un parti pris pro hellénique et anti-turc. Dans les deux cas, le lecteur de mes cartes aurait raison de critiquer ces choix assez douteux et anachroniques.

Le choix du flou
En revanche, le tracé des frontières et des pointillées dans la zone du Cachemire ou du Proche-Orient, le choix d’écrire Calcutta plutôt que Kolkatta sont mes choix mais ils sont cohérents avec une certaine réalité. Si un lecteur peut me faire des reproches en fonction de sa propre sensibilité sur ces sujets, il admettra nécessairement que ce choix repose sur une interprétation orientée (elle le sera dans un cas comme dans l’autre) mais légitime de la réalité. Ma crédibilité et celle de la carte restent donc entières.
Les frontières internationales sont régies par des organisations internationales. Rome est la capitale d’un État souverain reconnu, l’Italie, et nul ne conteste cela. La mettre en France est une absurdité. La situation au Cachemire est floue. Les trois États (Chine, Inde et Pakistan) y ont des revendications qui ne sont pas résolues à l’heure actuelle. Mon choix de représentation de ce cas de figure m’appartient donc et est légitimé par le flou existant.

extrait de la mappemonde classique 21maps.
Depuis peu, sur certaines cartes, je fais apparaître en pointillé la frontière entre le Bélize et le Guatémala car les deux états ne sont pas d’accord sur la frontière, mais les deux ont accepté de remettre la décision à une cour internationale. Les pointillées expriment donc cet état de sursis, mais je pouvais très bien laisser la frontière en trait plein suivant l’état actuel des choses.
La Toponymie et les Référentiels
La toponymie (les noms propres désignant les lieux) est très souvent soumise à des décisions internationales ou nationales. Pour mes cartes en langue française, je prends souvent comme source le « Trésor des noms de lieux » édité par le CNIG, le Conseil National de l’Information Géolocalisée, lui-même étant une commission placée auprès du Ministère de l’aménagement du territoire et de la transition écologique. M’y référer me permet donc une crédibilité. Y compris dans des choix qui ne seraient pas nécessaires mais que j’assume afin de garantir une certaine originalité et de légitimer certaines bizarreries que j’affectionne.
Des exemples ? Le choix d’écrire Assomption pour désigner le nom de la capitale du Paraguay. Ou encore Canton pour continuer à désigner le nom de la troisième plus grande ville chinoise au détriment de la nouvelle forme Guangzhou que tente d’imposer la Chine. Ces deux choix sont justifiés par le CNIG. À noter pour complexifier la chose que chaque langue a ainsi ses référentiels différents et sur mes cartes en langue anglaise, Assomption s’écrira Asunción et Canton s’écrira Guangzhou.

extrait de la mappemonde classique 21maps.
Mais dans ce cas, vu qu’en anglais, la Chine « m’impose » Guangzhou par son choix de transcription, est-il possible à un état d’imposer sa vision ? Plus ou moins, mais cela ne dépend pas entièrement de lui mais plus de l’usage et … du cartographe.
La Chine réussit à imposer l’usage du pinyin (une forme de transcription des sinogrammes chinois en caractères latins) dans la plupart des pays, organismes internationaux et médias. Ce qui fait que l’usage de Beijing s’est imposé de fait en anglais et parfois en français. Par exemple, le CIO qui parlera en français des Jeux Olympiques de Beijing plutôt que de parler des Jeux Olympiques de Pékin. Mais dans certaines langues comme le français, l’usage résiste. On continue alors largement plus de parler de Canton, de Pékin, mais aussi de Nankin (plutôt que Nanjing) ou du Fleuve Jaune (plutôt que du Huanghe). L’usage est ainsi reflété sur mes cartes. Il est bien aidé par ma conviction personnelle que le pinyin nuit gravement à la toponymie/exonymie francophone et donc à la langue française.
Résistance aux Changements Toponymiques
Mais d’autres États ont plus de mal. La Turquie tente depuis 2022 d’imposer son nouveau nom de pays Türkiye à l’international dans toutes les langues. L’ONU a cédé. Mais le côté très politique de ce choix d’Erdogan (et la personnalité de ce dernier) font face à de la résistance, y compris en langue anglaise pourtant très perméable habituellement à ce genre de modification. D’autres organisations internationales, bon nombre de médias et de publications continuent l’usage de l’ancien nom Turquie/Turkey. Et moi aussi je conserve sur mes cartes en langue anglaise le nom Turkey.
Cependant, dans certains cas (et si j’ai de la place), j’ajouterai alors les noms alternatifs et/ou historiques entre parenthèses. Je peux bien mettre (Beijing) en petit en italique sous Pékin par exemple, idem pour (Saïgon) sous Hô-Chi-Minh-Ville, ou (Asuncion) sous Assomption. Mais là encore, c’est mon choix et je ne mettrai pas (eGoli) sous Johannesbourg, (Riogénaire) sous Rio de Janeiro ou (Hayastan) sous Arménie car ces noms sont beaucoup trop politiques, peu usités, désuets et/ou ne reflètent pas un usage en français. Il s’agit donc encore une fois d’un choix personnel.
Ainsi, comme l’écrivit le géographe Mark Monmonier :
« Les cartes ne sont pas des miroirs de la réalité, mais des interprétations de celle-ci. »
Monmonier dans « Comment faire mentir les cartes ».
Mer du Japon et OHI
La Corée du Sud est en conflit frontal avec le reste du monde (et surtout le Japon) sur un hydronyme : la mer du Japon. En effet, elle appelle cette mer 동해, littéralement « mer de l’Est ». Or, le nom des mers est quelque chose de très sérieux et soumis à l’Organisation hydrographique internationale (OHI). Cet organisme international a parmi ses prérogatives celle d’uniformiser les cartes et documents nautiques. Cette dernière ne reconnaît que le terme « Mer du Japon ».

Le Golfe du Mexique
On pourrait croire que c’est exactement la même chose que tente Donald Trump avec le Golfe du Mexique, mais c’est pire que cela : contrairement à l’usage coréen qui est ancien et établi, le terme « Golfe d’Amérique » n’a aucune légitimité historique et n’existe que par la seule volonté d’un seul homme. Aucun usage pré-colombien ou même dans l’histoire géographique de l’Amérique-du-Nord, aucune mention n’existe de ce terme avant que M. Trump ne le sorte du chapeau. L’OHI n’ayant pas statué de changement de nom, le nom officiel reste donc Golfe du Mexique. Il n’y a aucune raison de le modifier si ce n’est que de se plier aux désirs d’un seul homme. Et comme 21maps n’est pas Google, il en restera ainsi sur mes cartes. Donald Trump en personne pourra me contacter en exigeant le changement. Je répondrai avec politesse que sa volonté n’est pas suffisante pour me faire changer d’avis en attendant l’OHI. Il fulminera certainement que la neutralité du cartographe n’existe pas, je lui répondrai qu’il a raison sur ce point.
Sur mes carte, le Golfe du Mexique reste le Golfe du Mexique, aucune mention ne sera faite de Golfe d’Amérique, même entre parenthèse.
Le cartographe est ainsi un artiste dont la particularité est de retranscrire une réalité. Il est donc contraint par l’exigence qui est attendue de lui de retranscrire celle-ci. Cependant il s’accordera toujours une liberté au sein même de l’interprétation qu’il en donnera. Chaque cartographe, du plus petit au plus grand devra faire des choix. Pour ma part, étant cartographe indépendant et free-lance, je n’ai de compte à rendre qu’à ma propre réputation. Celle-ci m’accorde la liberté de me faire plaisir sur Assomption ou Canton. Mais elle me demande de garder mon sérieux face aux desiderata des grands de ce monde. J’espère qu’il en sera toujours ainsi de mon vivant.
Je conclurai avec une autre citation que j’affectionne car elle illustre bien la poésie de mon art :
Une carte est un récit, une histoire que nous racontons du monde
Tim Robinson